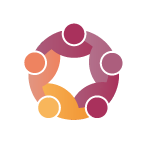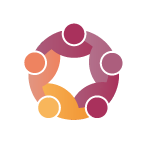par Aequivalens | Mai 13, 2025 | Inclassable
✨ Notre nouveau site est en ligne ! ✨ Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement de notre tout nouveau site internet : www.aequivalens.fr Un espace repensé pour mieux refléter notre vision, nos valeurs et notre engagement à vos côtés. Vous trouverez un tout...
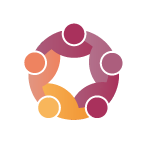
par Aequivalens | Juin 16, 2024 | Actualité du cabinet, Inclassable, Modes amiables de résolutions de différends et procédures
Les nouvelles audiences de règlement amiable (ARA) ont pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la...
par Aequivalens | Jan 2, 2024 | Inclassable
Madame, Monsieur, En ce tout début d’année 2024, je voudrais vous parler d’un mot qui me tient à cœur : la responsabilité. La responsabilité, c’est la capacité de répondre de ses actes, de ses paroles, de ses engagements. C’est aussi la conscience de...
par Aequivalens | Nov 30, 2023 | Inclassable
L’ARA, c’est quoi ?Un nouvel acronyme pour désigner l’audience de règlement amiable, encadrée par les articles 774-1 à 774-4 du Code de procédure civile, entrés en vigueur le 1er novembre 2023. Rien de nouveau sous le soleil, me direz-vous, puisque l’ARA semble être...
par Aequivalens | Mar 6, 2015 | Inclassable
D’ici quelques années, sans une réforme importante de l’examen d’entrée pour les avocats, c’est presque 3 600 nouveaux avocats qui rentreront chaque année sur un marché déjà très tendu.1 C’est sur ce postulat, afin de limiter l’explosion du nombre...